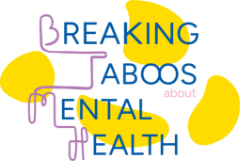Iwona Nowak est psychologue, thérapeute, formatrice, consultante et enseignante. Elle est spécialisée dans les domaines de la psychologie, de la psychothérapie, de la neurodidactique, du soutien psychologique et pédagogique ainsi que dans la gestion de l’éducation. Elle s’intéresse notamment à l’apprentissage « brain-friendly » (pour offrir les conditions optimales d’apprentissage convenant au cerveau humain), à la neurobiologie, à la psychothérapie, au management’ et à l’optimisation.
Ewa Grynicka : Bonjour, Iwona. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd’hui pour discuter de votre travail et de vos expériences dans le domaine de la santé mentale.
En lisant votre CV, j’ai été intriguée par la combinaison de deux domaines d’expertise : vous avez le titre d’enseignante – j’ajouterai que vous êtes une spécialiste de la langue et de la littérature polonaises – ainsi que celui de psychologue et de thérapeute. Comment ces deux rôles se chevauchent-ils dans votre travail et comment se complètent-ils ?
I. N. :J’ai été enseignante pendant la majeure partie de ma vie professionnelle, soit plus de 20 ans, et la psychologie a toujours été ma passion. Lorsque je travaillais comme professeur de langue et de littérature polonaises, j’ai consacré beaucoup de temps à l’apprentissage et à l’étude de sujets liés à la psychologie et au fonctionnement de notre mental. Cela m’a conduit vers la neurobiologie et la neurodidactique, en explorant la manière dont le cerveau apprend dans différentes conditions. Je voyais constamment le lien entre ce à quoi devrait ressembler le travail d’un enseignant et ce que nous savons aujourd’hui du fonctionnement du cerveau et de l’esprit humain. Je me suis rendu compte qu’il était de plus en plus nécessaire de me plonger dans cette discipline pour mieux jouer mon rôle d’enseignante. Cela m’a incité à suivre un cours de psychothérapie, puis à m’inscrire à des études de psychologie et enfin à fréquenter une école de psychothérapie.
E.G. : J’ai vu que vous vous préoccupiez du bien-être des élèves et des enseignants. Vous proposez également des formations dans ce domaine. Pourriez-vous préciser ce que ce concept signifie pour vous ?
I. N. :Oh, c’est un concept très vaste, et il est difficile de le résumer en quelques mots. Au sens le plus large, le bien-être d’un élève englobe son sentiment d’accomplissement, sa capacité à développer ses passions et ses intérêts, son sentiment d’autonomie, sa capacité à décider ce qu’il veut apprendre et comment il veut l’apprendre, dans quelles conditions, et le fait qu’il se sente en sécurité à l’école. Il s’agit également de recevoir le soutien et la compréhension des enseignants, des parents et des adultes en général. C’est la version idéale. Dans la pratique, nous y parvenons principalement en créant une atmosphère d’apprentissage positive à l’école, ce qui implique le respect des élèves, de leurs sentiments, de leurs pensées et de leur rythme de travail. Un autre aspect essentiel pour moi est d’enseigner dans une « culture de l’erreur », c’est-à-dire de donner aux élèves le droit de se tromper. Malheureusement, l’éducation traditionnelle, basée sur la détection de l’ignorance et du déficit de compétences des élèves, a tendance à l’oublier. Aujourd’hui, nous savons que cette approche n’est pas bénéfique pour le processus d’apprentissage, le développement ou le bien-être des élèves dont nous parlons. Dans de telles situations, les élèves passent leur journée à s’attarder sur leurs échecs, à se concentrer sur les erreurs qu’ils ont commises au lieu de reconnaître leurs réussites. Par exemple, ils peuvent se concentrer sur les six tâches qu’ils ont ratées au lieu des quinze qu’ils ont réussies. Cela a des conséquences négatives, car les élèves dramatisent excessivement des événements tels que le fait d’avoir obtenu la deuxième place plutôt que la première, ce qui affecte leur santé mentale et leur bien-être psychologique.
E.G. : D’après ce que vous dites, il semble que les enseignants aient tendance à se concentrer sur les lacunes des élèves plutôt que sur leurs points forts.
I. N. :Tout à fait. Et nous nous concentrons souvent sur ce que l’élève ne peut pas faire plutôt que sur ce qu’il peut faire. C’est une chose. Un autre aspect important est que nous n’insistons pas sur la beauté des erreurs et sur le fait que c’est un chemin vers l’apprentissage. Toutes les grandes inventions sont nées d’essais et d’erreurs pour finalement aboutir au résultat souhaité. Malheureusement, les adultes, y compris les parents et les enseignants, ne parviennent pas toujours à transmettre ce message aux jeunes. L’enfant se bloque et se ferme lorsque nous lui signalons ses erreurs, au lieu de prendre conscience que les erreurs sont tout simplement naturelles et qu’elles sont un moyen d’atteindre nos objectifs.
E.G. : Vous avez également mentionné que le bien-être des enseignants est très important. Pourriez-vous expliquer comment le bien-être des enseignants, qui travaillent et interagissent avec les élèves, affecte le bon fonctionnement des élèves à l’école ?
I. N. : Le bien-être est l’état émotionnel positif d’une personne, qui influence son fonctionnement et ses relations avec les autres. Si le bien-être d’un enseignant est perturbé, il ne sera pas en mesure d’établir des relations efficaces avec les autres, ce qui aura un impact significatif sur ses interactions avec les élèves. Si un enseignant est frustré, épuisé et se sent surchargé de travail, avec un manque de sentiment d’autonomie et d’expertise, cela se traduira dans son travail quotidien et, par conséquent, dans ses relations avec les élèves.
E.G. : Actuellement, vous travaillez notamment en tant que psychologue scolaire. Quelle est la tranche d’âge des élèves avec lesquels vous travaillez et quels sont les problèmes les plus fréquents pour lesquels les élèves viennent vous voir ?
I. N. :Je travaille dans un lycée, donc avec des jeunes de 15 à 19 ans. Ces jeunes viennent me voir pour des troubles anxieux, des phobies, des dépressions, des baisses de moral, un sentiment d’impuissance, la conviction qu’ils ne peuvent rien faire, qu’ils n’ont aucun contrôle sur leur vie, qu’ils manquent de passions et d’intérêts, que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Les conséquences de ces problèmes comprennent l’automutilation, les pensées suicidaires ou les tentatives de suicide.
E.G. : Un jeune qui s’automutile vient donc vous voir et vous cherchez à comprendre les raisons de ses actes, en allant au cœur du problème ?
I. N. :Oui, l’automutilation est un moyen de faire face à une tension et à une souffrance psychologique qui semblent impossibles à soulager d’une autre manière.
E.G. : Vous soulignez que vous êtes une » intervenante dans les domaines du renforcement du bien-être mental des jeunes « . Pourriez-vous décrire les outils, méthodes et techniques que vous utilisez et évaluer leur efficacité ?
I. N. :Il y a quelques années, lorsque j’ai commencé mon parcours de psychothérapeute, j’ai suivi un cours de thérapie centrée sur les solutions. Cette approche de la psychothérapie se concentre sur les ressources de l’individu et cherche des solutions plutôt que d’analyser et de rechercher les causes dans le passé. J’ai appliqué les principes de cette approche dans mon travail dans les écoles pendant de nombreuses années.
E.G. : Une dernière question – ce que j’admire beaucoup chez vous, c’est votre recherche permanente de solutions innovantes pour les parents, les élèves et les écoles dans le cadre de votre travail professionnel. Sur quoi travaillez-vous actuellement et quelles pratiques innovantes mettez-vous en œuvre dans votre travail ?
I. N. :C’est vrai. Lorsque l’on se rend compte que les méthodes d’enseignement traditionnelles ne soutiennent ni les étudiants, ni moi en tant qu’enseignante et ne sont pas propices au bien-être mental, on cherche de nouvelles solutions et on ne revient pas aux vieilles méthodes. Cependant, les méthodes et les outils sont secondaires. Parfois, j’ai été fascinée par des solutions innovantes, mais je suis revenue à ce qui fonctionnait le mieux pour moi dans mon travail avec les jeunes : la conversation, la discussion et la construction de liens avec les élèves. Bien sûr, nous pouvons toujours affiner cela. Dernièrement, ce qui me passionne, c’est la supervision des enseignants, le soutien au bien-être des enseignants en tant que groupe professionnel ayant diverses responsabilités.
E.G. : Si je résume le point clé de notre conversation, c’est que les indicateurs de la santé mentale des jeunes et de ceux qui travaillent avec les jeunes impliquent la prise de conscience, la connaissance, le refus des stéréotypes et une adaptation permanente parce que le monde évolue continuellement.
I. N. :Tout à fait, nous ne pouvons pas agir comme il y a quelques années, car nous disposons aujourd’hui de connaissances totalement différentes, en particulier dans le domaine de la neurodidactique. Je pense que le slogan « lifelong learning » (apprentissage tout au long de la vie) n’est pas dénué de sens, en particulier dans les métiers liés à l’aide, tels que les médecins, les psychologues et les enseignants.
E.G. : Merci, Iwona, pour cette conversation passionnante. Je repartirai non seulement avec une excellente interview, mais aussi avec une mine de connaissances et une perspective positive sur la journée, la semaine et tous les jours à venir.
I. N. :Merci beaucoup.